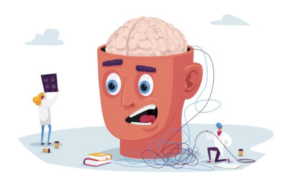
Les troubles neurovisuels chez l'enfant
Les recherches actuelles suggèrent que les déficiences visuelles d’origine cérébrale, plutôt que les troubles ophtalmologiques, sont les causes principales de troubles du développement de l’enfant.
Ces troubles, que l’on appelle troubles neurovisuels (TNV) font essentiellement suite à des épisodes d’asphyxie périnatale et/ou à la prématurité ou à l’hypoglycémie néonatale et restent encore trop souvent sous-diagnostiqués.
Pourtant en raison du rôle fondamental de la vision dans le développement , ces TNV sont susceptibles d’entraver le développement d’autres fonctions cognitives telles que l’attention, les fonctions exécutives, les gestes, la cognition sociale et d’avoir un impact sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture ou du calcul.
Il existe de ce fait un risque majeur de confusion entre les expressions des TNV sur le développement et d’autres troubles neurodéveloppementaux.
Sémiologie des troubles neurovisuels chez l'enfant
Selon la topographie et l’étendue de la lésion cérébrale, le déficit peut donc concerner le champ visuel, l’analyse visuelle, l’exploration visuelle, l’attention visuelle, la coordination visuomotrice ou encore la mémoire visuelle.
Altérations du champs visuel
Les déficits du champ visuel observés vont de la cécité corticale (absence de sensation visuelle malgré l’intégrité de l’oeil) au scotome (absence de sensation visuelle concernant uniquement une partie du champ visuel). Les troubles intermédiaires comprennent la vision tubulaire (réduction concentrique du champ visuel), ou son opposé, la vision périphérique (avec une perte du champ visuel central, alors que le champ visuel périphérique est préservé), l’hémianopsie latérale homonyme (perte du champ visuel contralésionnel) ou la quadranopsie (perte d’un quadrant visuel).
Il est important de noter que, les enfants atteints de TNV peuvent également présenter une dissociation entre leur perception consciente abolie et un type de perception non consciente (Vision aveugle ou implicite), qui leur permet d’éviter les obstacles et de traiter les informations visuelles dans leur champ visuel aveugle sans en avoir conscience.
En fonction de la taille, de la latéralisation et de localisation lésionnelle, ces amputations du champ visuel peuvent ou non être associées aux troubles de la cognition spatiale ou de la reconnaissance visuelle.
Troubles de l’exploration et de la cognition spatiale
Syndrome de Balint : Ce syndrome se caractérise par une triade de signes cliniques : un trouble massif de l’exploration visuelle volontaire dans l’ensemble de l’espace, une ataxie optique ou trouble massif de la coordination visuomotrice, une simultagnosie ou difficulté majeure à orienter son attention sur plusieurs stimuli présentés de manière simultanée. Les enfants présentant ce type de troubles n’ont pas la possibilité de contrôler leur regard et décrivent souvent “des yeux qui n’en font qu’à leur tête”, et ne peuvent traiter l’ensemble de la scène visuelle, de manière globale. Ces enfants décrivent ainsi le plus souvent une vision “morcelée”, comme s’ils regardaient à travers un kaléidoscope.
Négligence spatiale unilatérale : Elle se caractérise par des difficultés à réagir ou à agir face à des stimuli présentés dans l’hémiespace opposé à la lésion cérébrale. Ce déficit, dans lequel le patient se comporte comme si la moitié de l’espace d’un côté n’existait pas, peut être observé dans toutes les modalités sensorielles (visuelle, somésthésique, auditive, olfactive, gustative). La négligence peut s’exprimer au niveau moteur, notamment chez le jeune enfant.
Troubles de la reconnaissance visuelle
Les enfants atteints de ce type de troubles peuvent être incapables d’apprendre à voir, quelle que soit la nature du matériel visuel : objets, visages, lieux, langage écrit. Il n’est pas rare que des enfants diagnostiqués dyslexiques soient en réalité porteurs d’un trouble de la reconnaissance visuelle du langage écrit lié à un TNV d’origine centrale. On observe également souvent chez ces enfants des troubles de la mémoire et/ou de l’imagerie mentale visuelle et spatiale.
Troubles neurovisuels et troubles neurodéveloppementaux
La vision du fait de sa capacité à coordonner l’ensemble des systèmes sensorimoteurs, joue un rôle essentiel dans le développement cognitif de l’enfant. Elle permet également à l’enfant d’apprendre à travers l’imitation, un processus essentiel au développement humain. S’il n’est pas question d’attribuer l’ensemble des troubles des apprentissages à des troubles de la fonction visuelle, il est évident qu’à l’inverse, compte tenu du rôle de la vision dans le développement, les enfants présentant des TNV encourent un risque important de développer des troubles du développement intéressant l’ensemble de la sphère cognitive et sociale. Le diagnostic différentiel entre TNV et troubles des apprentissages est donc crucial, même s’il n’est pas encore systématique.
Troubles neurovisuels et lecture
Un trouble du champ visuel va forcément altérer la qualité de lecture. De même, un déficit massif de l’orientation de l’attention tel que la négligence spatiale unilatérale peut s’accompagner d’une dyslexie de négligence, où les erreurs vont concerner la partie négligée du texte et/ou des mots. La simultagnosie (incapacité à distinguer un stimulus lorsqu’il est présenté parmi d’autres) peut altérer les capacités de lecture, le patient ayant tendance à se focaliser sur les détails, peut avoir des difficultés pour regrouper les lettres pour constituer le mot. Un trouble de la reconnaissance du matériel orthographique peut également altérer la lecture et son apprentissage.
Trouble neurovisuel, coordination visuomanuelle et production gestuelle
Un TNV va être à même d’altérer les aptitudes psychomotrices de l’individu et peut être facilement confondu avec un trouble praxique ou une dyspraxie. La définition de la dyspraxie visuospatiale comprend un certain nombre de TNV (réduction du champ visuel, trouble de l’attention et de l’organisation spatiale) dont on peut penser qu’ils sont eux-mêmes responsables de la maladresse gestuelle. En effet, chez les enfants porteurs de TNV, l’utilisation de la vision aggrave la réalisation motrice, alors que les consignes verbales ou la réalisation d’une tâche sans contrôle visuel ont tendance à améliorer leurs performances.
Troubles neurovisuels chez l’enfant et interactions sociales
Les TNV gênent un grand nombre de processus nécessaires à la communication, comme la reconnaissance des visages, la perception des expressions faciales, des gestes, du mouvement et de l’environnement en général. Ces manifestations psychiatriques sont parfois tellement importantes qu’elles peuvent conduire au diagnostic de TSA malgré la présence connue et évidente d’une lésion cérébrale et d’une symptomatologie neurovisuelle. Se pose ainsi de plus en plus la question du diagnostic différentiel entre TNV et TSA.
Pour conclure, la prise en charge des enfants porteurs de TNV a pour but de véritablement restaurer l’ensemble des capacités de détection, de discrimination, d’analyse, de mémoire, d’attention visuelles, ainsi que les processus impliqués dans l’organisation et la représentation de l’espace.
